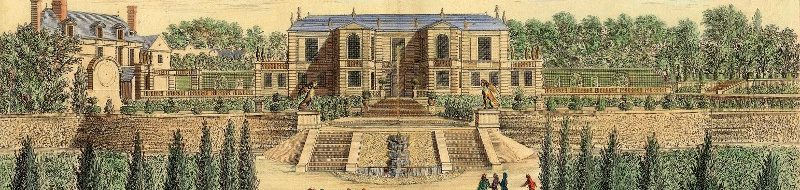Lettre exceptionnelle : les contributions
Pauline TANON
« Thérèse Rousseau,
La bien-aimée, mal aimée »
Version courte pour la Lettre exceptionnelle de l’Association Rousseau à Montmorency.
Dans le roman inédit « Thérèse Rousseau, La bien-aimée, mal aimée » de Pauline Tanon, la femme de Rousseau dicte en 1794 ses souvenirs. Voici ceux de 1769 :
« Nous dûmes à nouveau partir et accepter l’hospitalité d’une ferme à quelques lieues de Bourgoin. L’appartement qu’on nous donna au premier étage était commode et bien chauffé mais la vue était triste. Nul voisin alentour. Il n’était pas question de se promener».
Jeanjaque se réjouissait : sans risque de nous lier à qui que ce soit, ne se renouvelleraient pas les malheurs de Môtiers. La paix nous dédommagerait de notre isolement».
Il reprit alors l’écriture de ses Confessions entamée en Angleterre et qu’il allait parvenir à achever dans l’année. Je tournais en rond, les soirées étaient bien longues. Nous perdîmes doucement l’habitude de nous parler. Jeanjaque avait compris que ce nouveau texte n’était pas pour moi : aussitôt qu’il m’en faisait la lecture, je m’endormais.
Le printemps ranima mon courage. Comme j’ouvrais les fenêtres pour laisser pénétrer les premiers vrais rayons de soleil, un couple d’hirondelles vint prendre ses quartiers sur une poutre. Nous écoutions leur babil et respections leurs allées et venues en ne fermant la fenêtre que la nuit.
Je ressentis alors l’inconfort de dormir seule et trouvai que, marié de neuf, Jeanjaque ne devait pas passer toutes ses journées à écrire des souvenirs où je n’apparaissais presque pas ! Mais comment me faire entendre ? Je cassai un peu de vaisselle et brûlai une de ses chemises. Je menaçai même de le quitter.
Effrayé, Jeanjaque saisit, pour s’éloigner, le prétexte d’une promenade botanique. Je trouvai sur la table, le matin de son départ, une lettre que je crus devoir poster. Quelle surprise de découvrir qu’elle m’était destinée ! Je mis trois jours à la lire et à apprendre par cœur certains passages :
« Ne trouvant plus que des cœurs fermés ou faux, toute ma ressource, toute ma confiance est en toi seule ; le mien ne peut vivre sans s’épancher, et ne peut s’épancher qu’avec toi. Si tu me manques et que je sois réduit à vivre absolument seul, cela m’est impossible, et je suis un homme mort. Mais je mourrais cent fois plus cruellement encore, si nous continuions de vivre ensemble en mésintelligence ».
« Je ne puis rien changer en moi, et j’ai peur que tu ne puisses rien changer en toi non plus ».
« Je n’endurerais pas l’idée d’une séparation éternelle ; je n’en veux qu’une qui nous serve à tous deux de leçon ; je ne l’exige point même, je ne l’impose point ; je crains seulement qu’elle ne soit devenue nécessaire. Je t’en laisse le juge et je m’en rapporte à ta décision ».
« J’espère me retrouver en bonne santé dans vos bras, d’ici à quinze jours au plus tard ; mais s’il en était autrement, et que nous n’eussions pas le bonheur de nous revoir, souvenez-vous en pareil cas de l’homme dont vous êtes la veuve, et d’honorer sa mémoire en vous honorant. »
Rousseau fut absent une semaine. Sultan était rentré la veille, couvert de sang et de boue. J’avais longuement pansé ses plaies, puis imaginé une petite punition pour Jeanjaque. – « Mais où est Sultan ? », lui dis-je en lui ouvrant la porte. – « Perdu. Nous avons rencontré des chasseurs, il a été à demi massacré par un autre chien par l’effet d’une jalousie de caresses et de préférences ; il a disparu. Peut-être est-il mort de ses blessures ou mangé du loup.» – « Est-ce ainsi que tu prends soin de ton compagnon fidèle ? J’irai, moi, le chercher ! » Les larmes aux yeux, Jeanjaque avait déposé son paquet de nuit et sa boîte de botaniste. Je vis que sa main saignait. – « Le mont Pila est une montagne déserte. Aucun de mes mornes compagnons ne connaissait les bons endroits. J’aurais préféré être badin tout seul pour pouvoir folâtrer, criailler et chanter. La gentiana filiforma, très petite et très fugitive, m’a échappé. N’entends-tu pas quelqu’un gémir ? Y a-t-il un malade ? » – « Non, mais que t’es-tu fait toi-même ? » – « Je me suis foulé le poignet mais la blessure est superficielle, les doigts n’ont rien heureusement. Écoute… N’entends-tu vraiment rien ? » – « Non, rien, mais je vais chercher un bandage. » Et sous ce prétexte, j’allai ouvrir la porte de la resserre. Sultan bondit d’un trait dans les bras de son maître. Leurs effusions durèrent un long moment. Quand les deux blessés se souvinrent enfin de ma présence, ils surent me manifester l’un son repentir, l’autre sa gratitude.
Pauline TANON
Avril 2020
Pauline Tanon est autrice, metteure en scène et comédienne au sein de la compagnie Mistral Gagnant, avec laquelle elle monte des spectacles traitant des relations de l’homme avec la Nature. Elle a publié Armand Gatti, dans le maquis des mots (Actes Sud), Artistes inventeurs (Corps Reviver), Les Secrets des jardins (Librairie Vuibert
Laurent FERRERO
Mr, pauvre ROUSSEAU persécuté se retrouvant dans le ruisseau victime des encyclopédistes ; et oui la technologie en général tolérait l’herboristerie et les nouvelles méthodes d’écrire la musique.
Quel progrès que ces machines bonnes à tout même à tenir des armes ; l’empire est enfant de la révolution qui au départ était une réforme et la révolution industrielle anglaise celle d’un concours de circonstances de circonstances ; on dit souvent que WATERLOO aurait dû être une victoire française mais qui gagna la guerre du XIXème siècle ?
Le capitalisme des aciéries ou des filatures de coton, sauvages ou non ; ce fut aussi le siècle des nationalismes mais il ne faut pas rendre les deux siècles indissociables ; PAPIN naquit trop tôt et WATT en temps opportun ; DICKENS avec son » parallèle des deux villes « était bien sévère et la « déclaration des droits de l’homme et du citoyen » une émanation de l’inversion de rapports de force entre le guerrier l’aristocrate et l’habitant des villes qui, riche ou pauvre, était bourgeois ».
Le vrai vainqueur fut le riche « bourgeois ».
MARX lisait HONORE DE BALZAC et non ZOLA.
Laissons ce texte finir en musique avec MOISE MENDELSSOHN proche de MENDELSSOHN BARTHOLDY qui en fut une des charnières et GOETHE traitant VOLTAIRE d’homme du passé et ROUSSEAU de celui du futur.
Laurent FERRERO
Avril 2020
Jean-François RIAUX
Quand l’abominable se produit …
Fouillant quelque peu notre mémoire, aiguillonnée par l’adversité qui nous frappe, nous inclinerons à relire ces vers de Voltaire déposés dans son Poème sur le désastre de Lisbonne :
« […
Lisbonne, qui n’est plus, eut-elle plus de vices
Que Londres, que Paris, plongés dans les délices ?
Tranquilles spectateurs, intrépides esprits,
De vos frères mourants contemplant les naufrages,
Vous recherchez en paix, les causes des orages :
Mais du sort ennemi quand vous sentez les coups,
Devenus plus humains, vous pleurez comme nous.
…]
Le 1er novembre 1755, la ville de Lisbonne fut en grande partie détruite par un terrible séisme provoquant de multiples incendies et une effroyable submersion des quartiers situés au bord du Tage, précipitant le trépas de cinquante mille habitants. La première génération de la philosophie des Lumières subit cette tragédie comme un défi à tout esprit épris de réflexion. Comment interpréter une pareille calamité ? A l’heure présente, trois milliards d’hommes vivent sous la menace directe d’une infection virale aux effets galopants, aussi relèvent-ils d’un présent qui est comme le miroir du passé où affleurent des interrogations que les penseurs des Lumières ont déjà soulevées ; du commerce de leurs esprits ne peut-on tirer quelques remarques fécondes invitant à prendre quelque hauteur face à l’affligeant spectacle de nos contemporains anxieux, malades ou d’ores et déjà mortellement touchés ?
Lisbonne, ville martyrisée en ce premier jour de novembre 1755, s’offre comme un défi à toute conscience humaine toujours en quête de sens, même si, à l’école du malheur, il n’est pas aisé de tirer spontanément une leçon : Voltaire et Rousseau vont s’y attacher. Ni l’un ni l’autre n’ignoraient leur catéchisme vétérotestamentaire. L’un et l’autre savaient que Pharaon (Exode, 7, 14-25) dut souffrir des pires plaies imposées à son peuple : l’eau du fleuve changée en sang, les grenouilles infestant tout le territoire, les moustiques, le bétail décimé, les ulcères, la grêle, les sauterelles, les épaisses ténèbres, la mort des premiers nés. L’un et l’autre n’ignoraient point non plus à quels possibles fléaux le roi David (Samuel, 2, 24), après avoir ordonné le recensement de son peuple, allait exposer le royaume d’Israël : trois ans de famine, trois mois de guerre ou trois jours de peste. La catastrophe de Lisbonne, qui va susciter une ardente polémique entre Voltaire et Rousseau, peut-elle être interprétée à l’aune de ce que Pharaon et David ont subi ? Les plaies d’Égypte sont autant de malédictions divines attachées au refus de Pharaon de libérer les Hébreux ; quant aux menaces qui pèsent sur David, elles procèdent de sa décision d’outrepasser ses propres prérogatives en ordonnant le recensement du peuple d’Israël. Dans un cas comme dans l’autre, si l’on s’abstient d’insister sur le rôle prééminent de Yahvé, source de toute malédiction, que reste-t-il à interroger : moins le déroulé des événements eux-mêmes que la responsabilité des deux acteurs détenteurs d’ une posture de préséance –l’un est pharaon, l’autre est roi– impliquant qu’ils puissent revendiquer seuls la responsabilité de ce qui va advenir ; ce que le roi David laisse clairement apparaître : « C’est moi qui ai péché, c’est moi qui ai commis le mal, mais ceux-là qu’ont-ils fait ? » (Samuel, 2, 24). En somme le roi d’Israël incarne l’universel déchirement des âmes confrontées au malheur innocent dont elles sont la cause.
Rousseau ne récuserait pas ce point de vue, comme ces lignes de sa Lettre sur la providence (1756) l’attestent : « Je ne vois pas qu’on puisse chercher la source du mal moral ailleurs que dans l’homme libre, perfectionné, partant corrompu ; et quant aux maux physiques, ils sont inévitables dans tout système dont l’homme fait partie ; la plupart de nos maux physiques sont encore notre ouvrage ». Alors que Voltaire se satisfait d’une explication des catastrophes naturelles par le seul jeu des circonstances (« …du sort ennemi » nous devons accepter de « sent[ir] les coups »), Rousseau voit plus loin : au lieu de gémir au spectacle de notre propre impuissance face aux victimes immolées sur l’autel d’une obscure causalité naturelle, il n’hésite pas à stigmatiser une humanité qui, en raison de ses passions les plus communes (orgueil, avidité, cupidité, goût du lucre qu’excite l’activité marchande, etc.), s’est obstinée à se regrouper, à s’entasser, quitte à s’entretenir dans une cécité propre à nier sa vulnérabilité : « …la nature n’avait point rassemblé là [Lisbonne] vingt mille maisons de six à sept étages, et que si les habitants de cette grande ville eussent été dispersés plus également, plus légèrement logés, le dégât eût été beaucoup moindre et peut-être nul ». Les architectes, les maçons qui édifièrent Lisbonne, assurément, ignoraient qu’ils construisaient sur une zone sismique, mais ils appartenaient à une société désireuse de faire montre de sa puissance à travers une activité mercantile sans borne, asservissant toute une partie du monde, dès lors Lisbonne s’exhibait comme la figure de proue de la convoitise possessive, de l’accumulation sans frein ; immeubles, palais ostentatoires en étaient les icônes qu’on se devait d’idolâtrer.
Face à la « grosse pomme » paralysée par le funeste « coronavirus », face à Paris déserté, le séisme de Lisbonne, éradicateur de toute vanité marchande, joue comme un réitératif paradigme inquiétant. L’homme social, au bout du compte, s’est exposé au pire parce qu’il s’est avili sous la pression de son appétit de puissance qui fait le lit de son propre malheur. Si un cataclysme, si un virus peut faire s’effondrer les constructions de notre civilisation, c’est parce que celle-ci repose sur un contrat qui, comme Rousseau nous l’a appris, est un contrat de dupes. Elle donne à voir une interdépendance qui, par ses fruits apparents, donnent l’illusion d’une certaine solidarité. Or, l’auteur du Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes nous fait bien comprendre que cette illusion maquille une réalité, celle de la propriété qui, dans son devenir, cache des contradictions internes sous-jacentes à la prétendue paix civile. Dès son Discours sur les sciences et les arts, Rousseau a souligné à quel point la propension à vouloir jouir des agréments du luxe éloignait l’homme de sa relation à la nature et favorisait la concentration urbaine, elle-même propice à la circulation de germes délétères – il a d’ailleurs connu le confinement à Gênes en août 1743, enfermé dans un lazaret pendant vingt et un jours du fait d’une épidémie de peste–. Certes, il n’a pas anticipé le capitalisme marchand et la façon dont il allait étendre son maillage sur toute la planète, mais il nous a fourni les outils critiques pour exprimer la facticité d’une interdépendance de la production ; s’il invite un peu naïvement à promouvoir un type de production à taille humaine et quasi autarcique, c’est parce qu’il devine qu’une consommation qui supposerait une constellation d’appareils productifs dispersés ici et là dans le monde n’aurait d’autre origine que l’égoïsme de particuliers soucieux de s’enrichir ( comme ces grandes enseignes du textile qui règnent sur des fabriques exploitant la main d’œuvre la moins chère du monde, comme au Bangladesh). Qu’un sinistre vent souffle sur le maillage de l’échange marchand, c’est toute une mécanique qui s’effondre, révélant l’inconsistance des intérêts qui l’ont promue, Media vita in morte sumus*
* Au cœur de la vie nous sommes exposés à la mort (Roland de Lassus).
Jean François RIAUX
Avril 2020
Diplômé d’histoire des sciences, Jean-François RIAUX a été formé à cette discipline par Hubert SAGET, professeur à l’Université de Reims, lui-même disciple de Georges Canguilhem. Sa formation en philosophie et en littérature française l’a conduit à enseigner la culture générale et la philosophie en classe préparatoire aux Grandes Ecoles ; il reste associé comme intervenant au Centre Koyré d’histoire des sciences et au Centre d’Histoire des Systèmes de la Pensée Moderne (Paris 1). Désormais retraité, il enseigne la philosophie contemporaine à la faculté de théologie du Collège des Bernardins à Paris. Ses articles sont principalement publiés dans les Cahiers de philosophie du C.N.D.P. et dans la Revue des professeurs de philosophie de l’enseignement public.
Régine BELLEY
« Prenez le sens inverse de l’habitude et vous ferez presque toujours bien. » *
Gênes – 11 août 1743 – Jean-Jacques du haut de ses 31 ans, voyage sur une felouque en provenance de Toulon. La peste s’affale de Messine à Marseille. Le célèbre passager a le choix : soit il rejoint le sinistre hôpital dépourvu de tout, donc du nécessaire à toute guérison, soit contraint, il se confine sur son embarcation de fortune. Tous ses compagnons de voyage opteront pour la prison en felouque sauf Jean-Jacques qui curieusement, préféra « le lazaret ** ». On l’enferma derrière « de grosses portes et grosses serrures », en quarantaine pour vingt et un jours.
La situation n’est dramatique que pour les autres : plein d’humour, il se prend pour son héros préféré Robinson sur sa merveilleuse île du désespoir et, respectant un mode d’emploi méticuleux, il s’organise comme s’il allait nicher là pour l’éternité. Il compte avec ironie et élimine ses puces et ses poux puis se distrait à changer mille fois ses effets. Ensuite, il s’installe en choisissant des meubles à son goût, attache un soin particulier à sa robe de chambre, dispose l’écritoire, papiers et douze livres ; Point de rideaux car point de fenêtres ; nourri comme un moine sans le dogme, Jean-Jacques est prêt au confinement. Rousseau passe ses journées à lire, marcher, ou à fixer le puits de lumière, d’où il regarde les navires entrer et sortir du port. Capable de pourvoir ainsi à ses besoins, Zanetto est donc un solitaire heureux. Doté d’une farouche conscience et épris de liberté, l’homme, même confiné, est en mesure de résister à quelque état d’âme que ce soit, à ne céder à aucune forme de pitié de lui-même. Cependant, l’aventure fut écourtée de huit jours grâce à M. de Jonville, envoyé de France, qui parce que l’hôte n’était pas n’importe qui, l’accueillit dans sa maison.
Cette expérience est loin d’être dramatique pour le Philosophe, décidément doué et adaptable à la situation de crise : pas même l’once d’une quelconque forme d’ennui. Il n’y a pas de situation désespérée, il n’y a que des situations où l’on se décourage ! Mais voilà, Jean-Jacques ne perd pas courage et prouve qu’il est quelqu’un qui sait vivre. Le Sage stoïque sait gérer cette expérience inattendue avec le bon esprit, nous invitant à considérer ce qui dépend de nous et ce qui n’en dépend pas et à s’accommoder de ce qui n’en dépend pas. A cela s’ajoute le principe de l’amour de soi-même (et non l’amour propre, l’orgueil) qui est un sentiment naturel portant à veiller à sa propre conservation. Appuyons davantage le trait de l’argument : Jean-Jacques, combattant, se serait même senti « libre en prison », lui qui n’y a jamais mis les pieds.
De plus, souvenons-nous de l’enseignement du Philosophe, qui dans le Contrat Social nous indique combien l’intérêt commun doit primer sur la volonté particulière, même si chacun « peut comme homme avoir une volonté particulière contraire ou dissemblable à la volonté générale qu’il a comme citoyen ». Rousseau n’a décidément pas achevé son règne.
Enfin il convient de retenir de ses écrits que d’une catastrophe jaillit toujours une Renaissance. Voilà pourquoi il faut relire Rousseau.
*Prenez le sens inverse des habitudes et vous ferez presque toujours bien. « Prenez bien le contrepied de l’usage et vous ferez presque toujours bien ». Emile, livre deuxième
**Le lazaret : établissement de mise en quarantaine des passagers, équipages et marchandises en provenance des ports ravagés par la peste. Les confessions, livre 7.
Régine BELLEY
Avril 2020
Régine Belley est auteure de Ô Zanetto – Lettre à Jean-Jacques Rousseau chez Edilivre –
a remporté le Grand Prix 2019 du galet presse-livre de la Baie de Somme aux Estivales des Mots et des Arts de Cayeux sur Mer.
Jean Paul NARCY
Question Proposée par l’Académie de Sarcelles;
Si le progrès des connaissances a contribué à renforcer l’homme face aux grandes calamités.
PRÉFACE
Je n’aurais jamais osé répondre à cette question de l’Académie de Sarcelles si je n’avais pas eu à l’esprit les écrits de Jean-Jacques Rousseau. Mais, commençant ma réponse, je fus immédiatement stoppé par cette observation : l’état de la question n’avait pas changé, les réflexions de Rousseau s’appliquaient à la lettre et elles appelaient une réponse absolument négative ! D’où quatre conséquences :
1) Qu’il n’y ait rien à ajouter, en 2020, découle du bon sens. Le progrès des connaissances et les grandes calamités remontent à des millénaires. 1750 se situe à une distance considérable des commencements de l’homme et 2020 est à peu près à la même distance. Et cela se serait su si était arrivée une connaissance qui change tout face aux calamités.
2) Cela grandit encore la place de Jean-Jacques dans l’histoire de la pensée universelle. Il fallait qu’il y eût quelqu’un qui osât dire son fait à l’homme, celui-ci tellement orgueilleux de son savoir et de sa supériorité autoproclamée sur le reste de la nature. Et ce quelqu’un, ce fut lui.
3) La réponse négative ne signifie pas qu’il faille arrêter le progrès. Bien au contraire. Telle était aussi le point de vue de Rousseau, lui qui nourrissait des relations avec de nombreux savants de son temps et pratiquait les mathématiques, la chimie, la botanique et la linguistique.
4) Ma réponse devenait aisée. Il fallait rechercher chez Jean-Jacques le matériau nécessaire.
RÉPONSE
Après des heures de relecture, j’ai donné écho à la voix de Rousseau, en quinze fragments.
[1] Il semble que le sentiment de l’humanité s’évapore et s’affaiblisse en s’étendant sur toute la terre, et que nous ne saurions être touchés des calamités de la Tartarie ou du Japon, comme de celles d’un peuple européen. (Discours sur l’économie politique)
[2] La plus utile et la moins avancée de toutes les connaissances humaines me paraît être celle de l’homme. (Second Discours)
[3] Ce qu’il y a de plus cruel encore, c’est que tous les progrès de l’espèce humaine l’éloignant sans cesse de son état primitif, plus nous accumulons de nouvelles connaissances, et plus nous nous ôtons les moyens d’acquérir la plus importante de toutes. (Second Discours)
[4] À l’égard des maladies… en conservant la manière de vivre simple, uniforme, et solitaire qui nous était prescrite par la Nature… on ferait aisément l’histoire des maladies humaines en suivant celle des Sociétés civiles. (Second Discours)
[5] Ce n’est pas sans peine que nous sommes parvenus à nous rendre si malheureux. Quand d’un côté l’on considère les immenses travaux des hommes, tant de Sciences approfondies, tant d’arts inventés ; tant de forces employées ; des abîmes comblés, des montagnes rasées, des rochers brisés, des fleuves rendus navigables, des terres défrichées, des lacs creusés, des marais desséchés, des bâtiments énormes élevés sur la terre, la mer couverte de Vaisseaux et de Matelots ; et que de l’autre on recherche avec un peu de méditation les vrais avantages qui ont résulté de tout cela pour le bonheur de l’espèce humaine ; on ne peut qu’être frappé de l’étonnante disproportion qui règne entre ces choses, et déplorer l’aveuglement de l’homme qui, pour nourrir son fol orgueil et je ne sais quelle vaine admiration de lui-même, le fait courir avec ardeur après toutes les misères dont il est susceptible, et que la bienfaisante Nature avait pris soin d’écarter de lui… mais ce qu’il y a de plus dangereux encore, c’est que les calamités publiques font l’attente et l’espoir d’une multitude de particuliers… le grand et funeste incendie de Londres qui coûta la vie ou les biens à tant de malheureux, fit peut-être la fortune à plus de dix mille personnes… vous sentirez combien la Nature nous fait payer cher le mépris que nous avons fait de ses leçons. (Second Discours)
[6] En peignant les misères humaines, mon but était excusable et même louable à ce que je crois. Car je montrais aux hommes comment ils faisaient leurs malheurs eux-mêmes, et par conséquent comment ils les pouvaient éviter. (Lettre à Monsieur de Voltaire)
[7] Serait-ce donc à dire que l’ordre du monde doit changer selon nos caprices, que la nature doit être soumise à nos lois, et que pour lui interdire un tremblement de terre en quelque lieu, nous n’avons qu’à y bâtir une ville ? (Lettre à Monsieur de Voltaire)
[8] Ainsi toute la face de la terre est changée ; partout la nature a disparu ; partout l’art humain a pris sa place… c’est en vain qu’on pense anéantir la nature, elle renaît et se montre là où on l’attendait le moins. (L’état de guerre)
[9] Dans la condition mixte où nous nous trouvons [état civil au sein de chaque État mais état de nature entre États] … nous nous sommes mis dans le pire état où nous puissions nous trouver. Voilà, ce me semble, la véritable origine des calamités publiques. (L’état de guerre)
[10] Qu’on demande pourquoi les mœurs se corrompent à mesure que les esprits s’éclairent… [les habitants d’une grande ville] auront le front de nier le fait… ils ne connaissent que ce qu’ils voient et n’ont jamais vu la nature. (L’état de guerre)
[11] Étendue des États ! première et principale source des malheurs du genre humain, et surtout des calamités sans nombre qui minent et détruisent les peuples policés. (Considérations sur le gouvernement de Pologne et sur sa réformation projetée)
[12] Tout État libre où les grandes crises n’ont pas été prévues est à chaque orage en danger de périr. (Considérations sur le gouvernement de Pologne…)
[13] Tous les premiers mouvements de la nature sont bons et droits. Ils tendent le plus directement qu’il est possible à notre conservation et à notre bonheur : mais bientôt manquant de force pour suivre à travers tant de résistance leur première direction, ils se laissent défléchir par mille obstacles qui les détournant du vrai but leur font prendre des routes obliques où l’homme oublie sa première destination. (Rousseau juge de Jean-Jacques)
[14] Pourquoi toujours accusant le Ciel de leurs misères travaillent-ils sans cesse à les augmenter ? En admirant les progrès de l’esprit humain il s’étonnait de voir croître en même proportion les calamités publiques. Il entrevoyait une secrète opposition entre la constitution de l’homme et celle de nos sociétés. (Rousseau juge de Jean-Jacques)
[15] D’ailleurs je n’ai jamais vu que tant de science contribuât au bonheur de la vie. (Les Rêveries du promeneur solitaire)
En guise de conclusion, je donne la parole à Claude Lévi-Strauss.
La conférence donnée à Genève en 1962 portait ce titre : « Jean-Jacques Rousseau fondateur des sciences de l’homme ». Au début de l’exposé, Lévi-Strauss propose cette citation : « Quand on veut étudier l’homme, il faut apprendre à porter sa vue au loin ; il faut d’abord observer les différences pour découvrir les propriétés » (Essai sur l’origine des langues). Véritable définition avant l’heure de l’ethnologie.
Écoutez ensuite ces deux extraits de Tristes tropiques (1955). On a l’impression que l’ethnologue répond à l’Académie de Sarcelles. Par la négative mais avec un espoir :
Les zélateurs du progrès s’exposent à méconnaître, par le peu de cas qu’ils en font, les immenses richesses accumulées par l’humanité de part et d’autre de l’étroit sillon sur lequel ils gardent les yeux fixés.
Sachant que depuis des millénaires l’homme n’est parvenu qu’à se répéter, nous accéderons à cette noblesse de la pensée qui consiste, par-delà toutes les redites, à donner pour point de départ à nos réflexions la grandeur indéfinissable des commencements.
Pourquoi ne pas commencer, tout de suite, alors que le bénévolat et l’entraide explosent autour de la planète. Avec ce conseil de Jean-Jacques : Imitez la magnanimité des Romains, si soigneux, après les grandes calamités de leur République, de combler des témoignages de leur gratitude les étrangers, les sujets, les esclaves, et même jusqu’aux animaux. (Considérations sur le gouvernement de Pologne…)
Jean-Paul NARCY
Avril 2020
Jean Paul NARCY est Président de l’Association Rousseau à Montmorency, professeur de géopolitique et écrivain.
Odile NGUYEN-SCHOENDORFF
« Si Jean-Jacques revenait… »
Question : Si le Progrès des connaissances a contribué à renforcer l’homme face aux grandes calamités
Réponse à la question de l’Académie de Sarcelles :
Si Jean-Jacques revenait, trois cent huit ans après, s’il s’échappait du Panthéon, à supposer (ce qui a été mis en doute) que ce soient bien ses restes qui y demeurent, en face de ceux de son meilleur ennemi Voltaire…que dirait-il de ce qui nous arrive ?
A la question Si le progrès des connaissances a contribué à renforcer l’homme face aux grandes calamités, que répondrait-il, et nous, en fidèles rousseauistes, que répondrions-nous, à sa suite ?
Si l’homme ne se fût point égaré sur les chemins de l’inégalité, si quelqu’un n’était venu enclore un terrain, et proclamer « ceci est à moi ! » , nous aurions pu faire face de mieux en mieux aux grandes calamités, car l’homme dispose de l’intelligence, et de cette reine des facultés qu’est l’imagination. Il dispose aussi de la pitié envers son prochain, dont même les animaux les mieux doués montrent l’ébauche les uns envers les autres. L’homme est intellectuellement et moralement armé pour affronter les possibles catastrophes, dont, voulant nous laisser libres, ne nous prémunit pas la bonté divine. L’homme, étant doté de cette spécificité extraordinaire, bien qu’à double tranchant, qu’est la perfectibilité, ne cesse de développer ses compétences pour comprendre le monde qui l’entoure, et anticiper tous les possibles, y compris les pires. Certains chercheurs, comme Jean-Pierre Dupuy, avec son Pour un catastrophisme éclairé , n’ont-ils pas développé récemment la cindynique ou « science des risques » ?
Moi, Jean-Jacques, je proclame ici que j’en suis l’ancêtre ! Je ne suis pas ce masochiste, ce passéiste pleurnichard dont Voltaire a propagé la triste image, colportée, hélas, par quelques professeurs de littérature sans rigueur. Plutôt que la lettre de mes propos, tout le monde a retenu sa réponse brillante , mais malhonnête : « Il nous prend l’envie de marcher à quatre pattes en lisant votre ouvrage ! » Quelle singulière idée ai-je eue, aussi, en 1755, de lui envoyer mon Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes !
Je crois en l’homme et je crois dans les sciences. Toutes les sciences. N’ai-je pas pratiqué l’astronomie la nuit aux Charmettes, grimpant sur la montagne avec un télescope rudimentaire et vêtu d’une vieille robe de chambre de Maman (madame de Warens) ? Les paysans ont crié au sorcier !!! N’ai-je pas approfondi la botanique ? N’ai-je pas concocté un Traité de chimie, que peu d’entre vous connaissent, hélas ? Ne suis-je pas allé m’initier à la Médecine à Montpellier ? N’ai-je pas réclamé d’y assister à des séances de dissection ? Ah, si la médecine avait pu me délivrer de mes souffrances, moi qui ai souffert le martyre avec ma sonde sous ma robe et mon dolman d’Arménien !!! Au XXIème siècle, la science aurait bien allégé mon calvaire !
Je ne rejette pas le progrès scientifique et technique! Les descendants du cher Tronchin ont bien de la chance ! Je souhaiterais juste que le progrès moral l’accompagnât !
Un de mes admirateurs du XXème siècle, Claude Lévi-Strauss, ethnologue , a pensé suivre mes traces en partant chez les Yanomamis, dans le but d’y trouver l’homme le plus près possible de l’état de nature, je dis le plus près de l’état de nature, car l’état de nature est « cet état qui n’existe pas, qui n’existera jamais, et qui n’a probablement jamais existé ».
Cherchait-il le « bon sauvage » ? Non, car il m’avait bien lu. Le « bon » sauvage n’existe pas, mais ce qui existe avant l’état social, c’est le sauvage ni bon ni mauvais, ces sottes notions de moraline n’ayant pas encore été inventées, l’homme sans mensonge ni afféterie, pacifique et fraternel.
Paradoxalement (« Lévi-Strauss lui aussi est homme de paradoxes – plutôt que de préjugés- »), son livre, paru en 1955, porte le titre de Tristes Tropiques , car son escapade exotique et fugacement enchantée le ramène mélancoliquement après ce détour à un éloge du progrès. Et, à contre-coeur, il proclame : « Les progrès accomplis par l’humanité depuis ses origines sont si manifestes et si éclatants que toute tentative pour les discuter se réduirait à un exercice de rhétorique. (Race et Histoire)
Mais les « grandes calamités » me direz-vous ? L’incendie de Londres, le désastre de Lisbonne, et pour vous le Covid-19 et le Grand Confinement ?
J’ai répondu (grâce au bon Tronchin) le 18 août 1756, au Poème sur le désastre de Lisbonne de Voltaire, envoyé par un de ses amis, ou par lui-même, par malice. Son brûlot, destiné à désespérer les optimistes, adeptes de la Providence, disciples de Leibniz, prétendant que « tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles » au-delà de Pope et de Wolf, me visait-il moi aussi, moi qui persiste à croire en un Dieu bon, présent dans la nature ?
Assurément. « Voltaire, en prétendant toujours croire en Dieu, n’a réellement jamais cru qu’au diable, puisque son Dieu prétendu n’est qu’un être malfaisant qui, selon lui, ne prend de plaisir qu’à nuire. L’absurdité de cette doctrine, qui saute aux yeux, est surtout révoltante dans un homme comblé des biens de toute espèce, qui, du sein du bonheur, cherche à désespérer ses semblables par l’image affreuse et cruelle de toutes les calamités dont il est exempt. »
Pour ma part, je préfère – moi qui ai été beaucoup moins gâté par le sort que Voltaire, le Mondain – m’intéresser à ce qui dépend de l’homme, qui n’est pas seulement une victime, ou alors, la victime de ses propres erreurs :
« Je ne vois pas qu’on puisse chercher la source du mal moral ailleurs que dans l’homme libre, perfectionné, partant corrompu ; et, quant aux maux physiques, ils sont inévitables dans tout système dont l’homme fait partie ; la plupart de nos maux physiques sont encore notre ouvrage. Sans quitter votre sujet de Lisbonne, convenez, par exemple, que la nature n’avait point rassemblé là vingt mille maisons de six à sept étages, et que si les habitants de cette grande ville eussent été dispersés plus également, et plus légèrement logés, le dégât eût été beaucoup moindre, et peut-être nul. Combien de malheureux ont péri dans ce désastre, pour vouloir prendre l’un ses habits, l’autre ses papiers, l’autre son argent ? »
Puisque l’homme est l’auteur de ses maux, ou en tout cas d’une partie de ses maux, il peut aussi y trouver des remèdes ! Je vois que les siècles suivants ont fait des progrès dans les domaines de l’architecture et de l’urbanisme, de la résistance des matériaux et même de la prévision dans le domaine de la météorologie, des séismes, cyclones, tempêtes et autres tsunamis, même s’il reste beaucoup à faire…Félicitations aux savants de toutes disciplines !
Il en va de même dans le domaine de la médecine. Microbes et virus nous étaient totalement inconnus, même si nous avions depuis longtemps repéré le phénomène de la contagiosité des graves maladies provoquant de monstrueuses épidémies et pandémies, telles que la peste et le choléra.
Beaucoup y voyaient la punition des péchés de l’homme, et recommandaient la résignation, le fatalisme, ou la prière. Je leur réponds dans le Contrat Social : « Toute puissance vient de Dieu, je l’avoue; mais toute maladie en vient aussi : est-ce à dire qu’il soit défendu d’appeler le médecin? »
Nous aussi, nous nous confinions, pauvre parade moyenâgeuse, mais vous, au XXIème siècle, vous avez (pour certains) des masques, des tests, et bientôt un vaccin…Comment ? Pas encore ?!
Ah oui, il y a un ennemi dont vous êtes loin d’avoir triomphé ! Vous – ou vos maîtres, que vous avez élus – avez continué à courir après le profit. La cupidité l’a emporté sur la curiosité scientifique et le souci de l’homme ! Vous avez inventé la rentabilité. Vous avez cessé de fabriquer des masques. Après avoir créé des hôpitaux, vous avez fermé ceux qui ne rapportaient pas suffisamment, supprimé des lits…L’Argent est le maître mot ! Les inégalités galopent.
Pour vraiment renforcer l’homme face aux grandes calamités, il faudrait continuer à développer la science, c’est une évidence, mais pour qu’elle prenne tout son essor, et profite à tous, encore faudrait-il l’affranchir de la tutelle des nouveaux monarques et de leurs complices, les puissances d’argent. Peut-être faudrait-il que , revêtu ou non de gilets jaunes, le peuple (et non la foule) s’affranchisse de ses modernes tyrans, et fasse une nouvelle Révolution ?
Si je revenais j’écrirais un nouveau Contrat social. Peut-être faudrait-il retrouver la fibre romaine. Relisez la Prosopopée de Fabricius dans mon Discours sur les Sciences et les Arts. Peut-être est-il temps de retrouver la Vertu.
Odile NGUYEN-SCHOENDORFF
Avril 2020
Odile-Nguyen-Schoendorff, agrégée de philosophie, a enseigné en lycée et à l’Université Lyon III-Jean-Moulin. Philosophe et poète, elle a écrit de nombreux articles, recueils, essais, et biographies, dont une consacrée à son auteur préféré, objet aussi de plusieurs conférences : Rousseau : « je suis…Jean-Jacques Rousseau », chez Jacques André éditeur.
Pierre SASSIER
REFLEXIONS AUTOUR D’UNE QUARANTAINE
Un passage des confessions nous fait part d’une expérience vécue par Rousseau en Aout 1743, au cours d’un voyage sur une felouque en provenance de Messine, où s’était déclarée une épidémie de peste. A leur arrivée dans le port de Gènes l’équipage et les passagers sont mis en quarantaine, avec un choix : soit rester confinés sur le bateau, soit être mis à l’isolement à terre dans un lazaret. Rousseau choisit la deuxième option. D’un point de vue épidémiologique, c’était probablement la bonne, car les risques de contracter la maladie étaient bien plus élevés dans un milieu où il y avait déjà des porteurs potentiellement contaminés que dans un environnement vierge de toute infection. Un choix différent aurait pu priver la postérité de ses œuvres ultérieures, parmi lesquelles les trois œuvres majeures écrites pendant son séjour à Montmorency (l’Emile, le Contrat Social, la Nouvelle Héloïse), les rêveries d’un promeneur solitaire et, bien sûr, les confessions.
La peste dans la mémoire des peuples
Au siècle de Rousseau, on ne compte pas moins de 17 épidémies de pestes réparties sur quatre continents. Mais dès l’antiquité, elles accompagnent l’histoire de l’humanité et cette maladie, qui pouvait en quelques mois tuer le tiers d’une population comme cela a été le cas en France au 14ème siècle, a hanté l’inconscient collectif des peuples au point qu’on a appelé « peste » des épidémies qui n’avaient rien à voir avec le bacille de Yersin : ainsi, la « grande peste d’Athènes » qui a emporté Périclès et a été un des facteurs qui a entraîné la ruine de la cité était, si l’on en croit la description des symptômes qu’en fait l’historien Thucydide d’Athènes dans son ouvrage la guerre du Péloponnèse , probablement due au typhus, peut-être à une fièvre typhoïde (maladie qui n’a été formellement identifiée qu’au 19ème siècle) ou à une rougeole maligne. Mais un regard médical sur la description de Thucydide permet d’écarter formellement l’hypothèse de la peste.
Bien entendu, en ces temps de Coronavirus, on pourrait évoquer le confinement qui nous est imposé. Mais il n’y a de fait aucune analogie avec la situation qu’a vécue Jean-Jacques, même si, dans les deux cas, il s’agissait d’éviter la propagation de la maladie : à Gènes, il s’agissait d’une mise en quarantaine de personnes potentiellement contaminées et non d’un confinement généralisé qui aurait pu nourrir la pensée du philosophe sur un aspect révélateur de ces épidémies : l’absence d’égalité des êtres humains devant la maladie. Il ne s’agit évidemment pas des différences entre les systèmes de santé et de couverture sociale, inconnus du temps de Rousseau, mais seulement des conditions de la quarantaine ou du confinement.
On ignore que, dans nos pays occidentaux, la peste a continué ses ravages jusqu’au début du 20ème siècle : l’épidémie de peste de Paris, en 1920, a été complètement oubliée, peut-être parce que sa notoriété a été éclipsée par celle d’une grippe n’ayant d’espagnole que le nom, qui a tué de 50 à 100 millions de personnes dans le monde. Il n’en reste pas moins qu’elle a fait 106 malades déclarés et 34 morts et a persisté de 1921 à 1934, avec 45 cas pendant cette période. Le faible nombre de victimes, par comparaison avec les grandes pandémies du moyen Age, s’explique par le fait que le bacille pathogène était identifié et que l’on disposait de vaccins.
Ce que révèlent les grandes crises sanitaires
L’épidémie de peste de 1920 s’est déclarée et s’est propagée dans des quartiers insalubres. De la même façon, l’épidémie de coronavirus menace en premier lieu les bidonvilles indiens ou les favélas brésiliennes, où le confinement est impossible et où n’existe aucune aide sociale pour les populations concernées. Ce qu’aurait donc pu constater Jean-Jacques Rousseau s’il était revenu au moment de ces épidémies, c’est une autre forme d’inégalité des citoyens devant la maladie. Mais cela n’a rien à voir avec l’inégalité « naturelle ou physique », décrite dans le discours sur l’origine des inégalités « établie par la nature, et qui consiste dans la différence des âges, de la santé, des forces du corps » puisqu’il s’agit une conséquence institutionnelle de la pauvreté ou de la richesse. Elle doit être considérée comme « morale, ou politique, parce qu’elle dépend d’une sorte de convention, et qu’elle est établie, ou du moins autorisée par le consentement des hommes. La Sécurité Sociale mise en place au sortir de la deuxième guerre mondiale vise à réduire l’inégalité devant la maladie engendrée par la position sociale des hommes. La mise en place d’un panel de vaccinations obligatoires qui a évolué avec le temps a apporté sa contribution à cette égalité devant la maladie en éliminant des pathologies comme la diphtérie, la poliomyélite ou la variole. Tout cela a aussi contribué à la diminution importante de la mortalité infantile, qui était un véritable fléau au 18ème siècle. Il est permis de penser que les progrès d’une médecine devenue accessible à tous ont mis fin à la fatalité qui faisait de la maladie une « inégalité naturelle » et que les mesures qui en découlent auraient rencontré l’approbation et le soutien de Jean-Jacques Rousseau.
Les épidémies de peste sont également le révélateur d’un aspect peu reluisant de l’espèce humaine, celle qui consiste à toujours chercher un bouc émissaire à l’origine des maux qui frappent l’humanité. Dans le cas des pestes, c’était la « fonction sociale » des communautés juives persécutées sous n’importe quel prétexte des croisades au troisième Reich. Ce discours, qui était celui tenu lors de la grande peste du 13ème siècle, a été repris après l’épisode de 1920 par des personnalités d’extrême droite qui n’avaient même pas l’excuse de l’ignorance. Or si le siècle des lumières a débouché sur la citoyenneté pleine et entière enfin accordée aux juifs au moment de la Révolution, c’est parce qu’il y a eu, au 18ème siècle, quelques grands esprits capables d’aller contre les idées de leur temps. C’est l’occasion pour nous d’examiner, dans le contexte des autres penseurs du 18ème siècle, quelle a été la place de Rousseau.
Au moment des croisades, la seule voix qui s’élève contre les pogroms est celle de Bernard de Clairvaux qui, en une phrase, reconnait la filiation entre le judaïsme et le christianisme : « Ne touchez pas aux juifs, car ils sont le sang et les os du Christ ». Cette filiation sera soulignée par l’ensemble des philosophes du 18ème siècle, mais nous verrons maintenant que seules les pensées de Montesquieu et de Rousseau ont pu avoir eu une influence déterminante sur l’octroi de la citoyenneté aux juifs.
Pensée des lumières et condition sociale des juifs
Montesquieu n’exprime pas de sympathie particulière pour les communautés juives, mais il est permis de considérer son œuvre comme un des écrits fondateurs de la laïcité à la française. Il rappelle dans les Lettres Persanes les dommages subis par l’Espagne, lorsque Isabelle la Catholique a expulsé les juifs, et par la France lorsque Louis XIV a voulu frapper d’alignement les croyances religieuses de ses sujets en révoquant l’édit de Nantes. Ensuite, il commente : « On s’est aperçu que le zèle pour les progrès de la religion est différent de l’attachement qu’on doit avoir pour elle ; et que, pour l’aimer et pour l’observer, il n’est pas nécessaire de haïr et de persécuter ceux qui ne l’observent pas. » Le respect des croyances d’autrui et la tolérance envers elle fait donc partie de la pensée du philosophe et c’est dans l’esprit des lois qu’il s’adresse aux inquisiteurs : « Il faut que nous vous avertissions d’une chose, c’est que si quelqu’un dans la postérité ose jamais dire que, dans le siècle ou nous vivons, les peuples d’Europe étaient policés, on vous citera pour vous prouver qu’ils étaient barbares. Et l’idée qu’on aura de vous sera telle qu’elle flétrira votre siècle et portera la haine sur tous vos contemporains ». Malgré la distanciation que Montesquieu prend avec toutes les religions – ou peut-être à cause d’elle – divers auteurs s’accordent pour attribuer à Montesquieu un rôle majeur dans l’émancipation des juifs. Voltaire a tenu des propos très virulents vis-à-vis de l’enseignement biblique, fait de massacres, d’assassinats, d’incestes et surtout de cette prétention qu’il n’existe qu’un seul peuple élu. Ses propos nourrissent le livre du professeur d’histoire Henri Labroue, intitulé Voltaire antijuif, qui, sur 250 pages, se veut un catalogue de tous les écrits anti-juifs attribués au philosophe. On peut regretter que Léon Poliakov, historien de l’antisémitisme et juif lui même, ait assis sa démonstration de l’antisémitisme voltairien sur ce livre de propagande publié en 1942 (il avait été approuvé par Goebbels) sous la signature d’un collaborateur et antisémite notoire, car les tentatives de récupération par l’extrême droite ne sont en rien le reflet d’une pensée : le mythe du surhomme de Nietzsche n’a-t-il pas servi lui-même de base idéologique aux nazis pour mettre l’Europe à feu et à sang ? La pensée de Voltaire se précise dans cette citation du serment des cinquante : « il y eut toujours chez les juifs les gens de la lie du peuple qui firent les prophètes pour se distinguer de la populace : voici celui qui a fait le plus de bruit et dont on a fait un Dieu : voici le précis de son histoire en peu de mots, telle qu’elle est rapportée dans les livres qu’on nomme évangiles […]. Vous savez avec quelle absurdité les quatre auteurs se contredisent ». La cible du patriarche de Ferney se révèle donc être le prophétisme qui est l’ossature même de la Bible, mais en y incluant aussi les fondements de la tradition chrétienne qu’il considère comme le « pervertissement de la religion naturelle ». Voltaire antijuif ? Peut-être, mais cet antijudaïsme n’a rien à voir avec l’antisémitisme moderne dont le caractère idéologique a servi de justification à un génocide. Mais on peut au moins comprendre que le rôle de Voltaire dans l’intégration des juifs à la nation a été négligeable. Diderot évoque la question juive d’un point de vue historique et philosophique, qui exclut toute critique de la croyance religieuse. C’est dans les textes de l’Encyclopédie que l’on trouve ses principales contributions à la question juive : il voit dans la Cabale juive « un mélange confus des principes de la raison et de la révélation, une obscurité affectée et souvent impénétrable, des principes qui conduisent au fanatisme, un respect aveugle pour l’autorité des docteurs, en un mot, tous les défauts qui annoncent une nation ignorante et superstitieuse ». Dans ces propos, dont on devine facilement qu’ils sont antijuifs aux yeux de certains commentateurs, le mot « nation » peut sembler inapproprié, mais d’autres écrits suggèrent qu’il est employé à dessein : dans son introduction aux grands principes ou réception d’un philosophe, il mentionne que « la religion des juifs et celles des autres peuples chez lesquels ils habitent ne leur permettant pas de s’incorporer avec eux, ils doivent faire une nation à part ». Ces propos ne sont pas la marque d’une hostilité aveugle vis-à-vis des juifs, car une correspondance entre Diderot et la grande Catherine révèle que le philosophe n’était pas indifférent au sort des communautés juives de Russie. De plus, dans le chapitre de l’encyclopédie sur les croisades, il commente les atrocités commises par les croisés contre les juifs de la façon suivante : « ils croyaient, ces insensés et ces impies, venger directement la mort de Jésus-Christ en égorgeant les petits fils de ceux qui l’avaient crucifié ». La philosophie des lumières ne mériterait pas ce nom si elle n’avait pas rompu avec la fiction moyenâgeuse du « peuple déicide » qui justifiait tous les pogroms dénoncés en son temps par Bernard de Clairvaux. Mais les écrits de Diderot suggèrent qu’il ne considérait pas la citoyenneté des juifs comme un objectif primordial des lumières. Rousseau, pas plus que Montesquieu, n’a donné prise par ses écrits aux accusations d’antisémitisme et il est même le seul à exprimer, dans la profession de foi du vicaire savoyard, une véritable sympathie pour les juifs : Rousseau met dans la bouche de son vicaire une déclaration préconisant pour les juifs «un état libre, des écoles, des universités où ils puissent parler et disputer sans risques. Alors, ajoute le vicaire, nous pourrons savoir ce qu’ils ont à dire ». C’est chose faite aujourd’hui. Mais Rousseau, qui parlait dans le discours sur les origines de l’inégalité de « celui qui le premier qui, ayant enclos un espace a dit c’est à moi… », ne pourrait que constater que c’est ce qui a été fait en Cisjordanie. On est aussi en droit de se demander ce qu’il penserait en constatant que la création d’un état juif, mais non laïque, a engendré une inégalité institutionnelle entre les ressortissants des deux nations qui peuplent la Palestine. Mais Rousseau jette également un regard historique sur les tribulations millénaires des juifs : dans les considérations sur le Gouvernement de Pologne, il voit en Moïse celui qui osa instituer « en corps de nation un essaim de malheureux fugitifs sans arts, sans armes, sans talents, sans vertus, sans courage » et loue la pérennité de cette institution « que cinq mille ans n’ont pu ni détruire, ni altérer ». Il constate dans le contrat social que « Sion détruite n’a point perdu les siens. Ils n’ont plus de chefs et sont toujours peuple, ils n’ont plus de patrie et sont toujours citoyens ». Rousseau attribue donc la cohésion de cette nation sans état à la solidité d’une tradition que les pires catastrophes n’ont pu altérer et refuse la haine des chrétiens envers un peuple qui n’a pas reconnu Jésus. Ce sont au contraire les clercs qui ont dévoyé le message évangélique en prêchant des guerres prétendument « saintes » au nom d’un homme qui disait « heureux les artisans de paix » et en dressant des bûchers au nom du même homme qui disait « aimez vos ennemis ».
Un hommage en allemand au siècle des lumières
Nous terminerons par un fait anecdotique : une expression allemande souligne indirectement que si, pendant la révolution, la France a accordé la citoyenneté pleine et entière aux juifs, elle le doit aux écrits des lumières : « Glücklich wie Gott in Frankreich » (heureux comme Dieu en France), traduit un état de félicité parfaite. Pendant longtemps, j’ai demandé à mes amis allemands ce qui leur faisait croire que Dieu était plus heureux en France qu’en Allemagne, jusqu’à ce que je découvre l’explication au hasard d’une lecture : ce sont les ashkénazes qui ont inventé cette expression yiddish – passée ensuite en allemand en raison de la proximité des deux langues – qui sonne aujourd’hui comme un hommage à la philosophie des Lumières.
Source : La partie « pensée des lumières et condition sociale des juifs » est une fiche de lecture tirée d’un exposé de 15 pages visible sur Internet, intitulé « l’image et la place des juifs chez les philosophes des Lumières », par Pascale Pellerin, chargée de recherche au CNRS
Pierre SASSIER
avril 2020
Pierre Sassier est trésorier de l’association Rousseau à Montmorency, médecin retraité et détient un doctorat en biologie d’une université canadienne. Il est également membre de deux associations défendant des causes écologiques.
Gabrielle DE CONTI
«Ils ne mouraient pas tous mais tous étaient frappés»
( Jean de La Fontaine)
On peut se demander quelles sont les causes de la pandémie qui nous oblige au confinement aujourd’hui. L’apparition de ce terrible virus covid-19 serait selon les scientifiques, naturelle, car transmise d’un animal à un homme (le pangolin). Au XVIIIème siècle, Jean-Jacques Rousseau mettait déjà l’humanité en garde contre « les monstrueux mélanges des aliments, à leurs pernicieux assaisonnements, aux denrées corrompues, aux drogues falsifiées …»* Le réchauffement climatique n’est pas en reste car la fonte des glaciers a laissé réapparaître des virus potentiellement pathogènes, comme le charbon.
Notons que la pandémie a démarré dans le pays le plus peuplé et le plus pollué du monde : la Chine, et dans une ville de plus de 11 millions d’habitants : Wuhan. La pollution, première cause de mortalité mondiale, semble être un facteur aggravant. Elle fragilise en premier lieu nos poumons, lieu d’élection du virus. Jean-Jacques Rousseau avait déjà pensé ce phénomène : « Si vous faites attention aux maladies épidémiques engendrées par le mauvais air parmi des multitudes d’hommes rassemblés… vous sentirez combien la nature nous fait payer cher le mépris que nous avons fait de ses leçons…. »*
Rousseau énonce aussi que « La plupart de nos maux sont notre propre ouvrage. »* Après le tremblement de terre de Lisbonne de 1755 qui fit 60.000 morts, Voltaire rédige un long poème exprimant son pessimisme quant à la rationalité du monde. La réponse de Rousseau est magistrale :
« Les maux auxquels nous assujettit la nature sont moins cruels que ceux que nous y ajoutons… Convenez par exemple que la nature n’avait point rassemblé là 20.000 maisons de six à sept étages, et que si les habitants de cette grande ville eussent été dispersés plus également et plus légèrement logés, le dégât eut été beaucoup moindre et peut-être nul. »*
Il est évident que nos comportements ont une influence sur les catastrophes qui s’abattent sur nous. La pensée de Rousseau est toujours d’actualité. Prenons soin de nous, et des autres…
*Discours sur les origines de l’inégalité entre les hommes + Lettre à Monsieur de Voltaire.
MUSÉE VOLTAIRE
La maison de Voltaire à Genève, nommée « Les Délices », est plantée au centre d’un immense jardin. Les hautes fenêtres éclairent de spacieuses pièces. Le parquet et les boiseries vernies resplendissent de propreté. Tout y est luxe. C’est beau oui, mais y vivre ? Voltaire y invita Rousseau qui finalement n’y vint jamais. Les deux philosophes ne se sont en réalité jamais rencontrés. La maison des Charmettes ou celle de Montmorency, demeures beaucoup plus simples et modestes, pourvoyaient aux besoins de Jean-Jacques pour qui « Le luxe est un remède bien pire que le mal qu’il prétend guérir ». Face à la misère du monde, le luxe n’est-il pas une insulte à la pauvreté ?
La magnifique bibliothèque du musée permet l’étude de la correspondance entre Voltaire et Rousseau. Répartie en plusieurs gros ouvrages, elle commence courtoisement. Jean-Jacques lui écrit dès 1745 : « Votre pensée du beau et du vrai…». Voltaire le félicite d’emblée comme musicien et écrivain : « Vous réunissez deux talents qui ont toujours été séparés jusqu’à présent ». Il apprécie son œuvre et il aime sa Profession de foi du Vicaire Savoyard. Rousseau se présente à lui comme « un solitaire qui ne sait point parler, un homme timide, découragé… ». Puis paraît la critique de Voltaire du Discours sur les origines de l’inégalité, où il accuse Rousseau de nous vouloir faire marcher à quatre pattes. Par la suite, il l’attaquera indirectement sur les vertus.
Voltaire a bâti sa fortune dans le commerce militaire. Drôle de philosophie n’est-ce pas ? Rousseau écrit concernant la guerre, dans le Contrat Social : « Le détail des horreurs qui se commettent dans les armées par les entrepreneurs des vivres et des hôpitaux… leurs manœuvres non trop secrètes par lesquelles les plus brillantes armées se fondent en moins de rien, font plus périr de soldats que n’en moissonne le fer ennemi». Par « Faire son profit aux dépens d’autrui », Voltaire n’est-il pas clairement visé ? Il n’est pas étonnant qu’il ait aussi violemment attaqué Rousseau, le vertueux et honnête auteur de la maxime :
« Chacun trouve son compte dans le malheur d’autrui »
Voltaire, agacé par les succès naissants de Rousseau et par son courage d’oser dire sa vérité, le traite de domestique. Qu’un homme d’une condition inférieure le dépasse spirituellement lui est insupportable. Dans sa jeunesse, Jean-Jacques avait servi comme laquais chez des nobles à Turin. Mais ses talents, vite remarqués par ses maîtres, l’élevèrent au rang de secrétaire. S’il avait eu le courage d’étudier plus avant, Rousseau aurait pu devenir ambassadeur.
Après le tremblement de terre de Lisbonne de 1755 qui fit 60.000 morts, Voltaire rédige un long poème exprimant son pessimisme quant à la rationalité du monde. La réponse de Rousseau est magistrale. Une véritable leçon de philosophie, de littérature, de sagesse, de vérité et de virtuosité. Sa pensée y est éblouissante. Rousseau reporte la responsabilité de certaines catastrophes sur l’humanité elle-même. Voici quelques traits de son génie :
« Les maux auxquels nous assujettit la nature sont moins cruels que ceux que nous y ajoutons… Convenez par exemple que la nature n’avait point rassemblé là 20.000 maisons de six à sept étages, et que si les habitants de cette grande ville eussent été dispersés plus également et plus légèrement logés, le dégât eut été beaucoup moindre et peut-être nul ».
Rousseau réagit aux plaintes de Voltaire dans cette lettre extrêmement longue :
« Rassasié de gloire et désabusé des vaines grandeurs, vous vivez libre au sein de l’abondance ; bien sûr de votre immortalité, vous philosophez paisiblement sur la nature de l’âme, et si le corps ou le cœur souffre vous avez Tronchin pour médecin et ami ; vous ne trouvez pourtant que mal sur la terre. Et moi, homme obscur, pauvre et tourmenté d’un mal sans remède, je médite avec plaisir dans ma retraite et trouve que tout est bien… Vous m’affligez Monsieur en disant que tout est mal… Vous êtes un privilégié et vous n’êtes jamais content alors que moi, pauvre et malade… ».
Rousseau cite Pope, puis Leibniz et ajoute : « Homme, prends patience, les maux sont un mal nécessaire de la nature et de la constitution de cet univers… Une mort accélérée n’est pas toujours un mal réel et qu’elle peut quelquefois passer pour un bien relatif ».
Voltaire n’a pu digérer une telle leçon. Il publie alors des calomnies sur le compte de Rousseau et un pamphlet sur l’abandon des enfants. Parallèlement, des esprits malveillants travaillent à les brouiller en publiant leurs correspondances. Dès lors ils deviennent irréconciliables. Voltaire le déprécie partout, et jusque dans ses exils « on » continue à nuire à Jean-Jacques par des lettres anonymes ou falsifiées.
Son éditeur Marc Michel Rey, qui suit toute la brouille, écrit à Jean-Jacques concernant Voltaire : « Cet homme est je crois le plus fourbe qu’il y ait… Il travaille sans cesse à des ouvrages répréhensibles contre la religion et les mœurs puis quand on le chicane, il nie comme beau diable et sacrifie tout pour se tirer d’affaire… Je suis persuadé qu’il fera tout ce qui sera en son pouvoir pour vous nuire, ne fut-ce que pour se venger… ». Voltaire se dédouanera ainsi : « Je ne me suis vengé qu’en plaisantant… ».
Malgré toutes les persécutions dont Jean-Jacques a été l’objet de la part de Voltaire, pas rancunier du tout, il participe à la souscription d’une statue à l’effigie de son persécuteur. Cher lecteur, connais-tu quelqu’un qui soit capable d’une telle abnégation ?
Pour le consoler, Goethe dira : « Avec Voltaire c’est le monde ancien qui finit, avec Rousseau, c’est un monde nouveau qui commence. »
Gabrielle De Conti
SUR LES CHEMINS DE JEAN-JACQUES
Edition UNICITE
avril 2020.
Gabrielle De Conti est auteure de deux livres : Sur les chemins de Jean-Jacques aux éditions Unicité, et de La cascadeuse, chez l’Harmattan.
Elle a auparavant participé à une centaine de films comme comédienne ou cascadeuse.
Rémy HILDEBRAND
Comité européen Jean-Jacques Rousseau (*)
Président-fondateur du « Comité européen Jean-Jacques Rousseau »
Depuis plus de 30 ans, cette institution (CEJJR) s’emploie à mieux faire connaître la vie et l’œuvre de Jean-Jacques Rousseau ; publications, colloques, articles, visites, enseignement.
Un nouveau contrat social s’impose !
Quelques circonstances prises au hasard
En 1665, l’Université de Cambridge ferme ses portes, la peste noire sévit en Angleterre. Isaac Newton retourne dans sa propriété dans la campagne anglaise. A l’écart Newton, renouvelle les concepts mathématiques et physiques et rédige – les lois de la gravitation universelle, force gravitationnelle responsable de la chute des corps, en observant tomber une pomme,
– les lois de l’optique, en un mot la lumière se propage en ligne droite,
– le calcul différentiel, outil préférentiel d’études des surfaces et des espaces.
Son isolement permet d’accomplir un grand pas dans le domaine scientifique. Dans son confinement, il crée de nouveaux concepts. L’homme devient moins ignorant de son univers.
En 1832, l’épidémie du choléra fait rage lorsque Angelo Pardi – héros du Hussard sur le toit (1) – arrive à Manosque. A la recherche de Giuseppe, son ami et frère de lait, il tente, dans un hôpital de campagne, de sauver un médecin et une jeune femme – Pauline – à la recherche de son époux. Cet homme et cette femme croisent son chemin, ils bouleverseront sa vie.
Mis en quarantaine, Angelo lutte contre la mort qui risque également d’emmener Pauline. Angelo la sauve, puis après un long périple, elle retrouve son mari.
Le choléra, allégorie du don de soi et de l’amour, transforment un noble italien et une épouse heureuse de respecter son engagement inconditionnel. Le hussard vainc sa peur, l’épouse fait triompher l’amour. Heureux destins, glorieuses leçons de vie.
En 1947 à Oran, Albert Camus raconte les ravages de la Peste (2) autre nom pour parler du nazisme. La lucidité, le courage, le dévouement deviennent des instruments d’opposition à un fléau frappant chacun. S’opposer aux ravages, résister au découragement, refuser la disparition des siens, quelle leçon ! Seul l’acharnement fraternel et la solidarité de tous viendront à bout de ce fléau. L’humanité active s’impose comme une nouvelle morale de situation. La révolte rend hommage à la dignité de l’être humain.
En 2015, au printemps le tocsin a sonné dans les steppes du Kazakhstan : 200 000 antilopes saïga sont mortes en trois semaines ; la steppe était jonchée de cadavres. On a compris plus tard qu’une bactérie, présente dans l’organisme de l’antilope sans normalement causer de dommage, a provoqué un empoisonnement foudroyant du sang et du fait de conditions météorologiques très inhabituelles de température et d’humidité. Avec le changement climatique ces conditions seront régulièrement réunies ; l’antilope saïga est devenue, sans transition, une espèce en voie d’extinction. (3)
Le 10 juillet 1743, Jean-Jacques Rousseau est engagé par le comte de Montaigu, ambassadeur de France en poste à Venise. Il quitte Paris et compte arriver rapidement à Venise, sa nouvelle fonction l’attend. Pourtant à Gênes, il est mis en quarantaine.
Jean-Jacques Rousseau raconte : Je fus conduit dans un grand bâtiment à deux étages absolument nu (…) … comme un nouveau Robinson je me mis à m’arranger pour mes vingt-et- un jours comme j’aurais fait pour toute ma vie. (4)
Méditation
Chacune de ces situations ne seraient-elles pas l’occasion de nous dispenser un enseignement ? Posons-nous la question : comment accepte-t-on les contrariétés, faisons-nous face aux peurs engendrées par la guerre ou la maladie. L’honneur pour les uns, l’amour pour les autres deviennent des boussoles existentielles.
La privation de la liberté devient un combat de tous les instants, une survie morale urgente. Le confinement des uns devient source d’inspiration, de méditation, d’esprit créatif. Jean-Jacques Rousseau nous montre un chemin : celui d’une patiente réflexion sur son existence et les événements de la vie quotidienne. L’examen de ses relations, la confrontation avec son environnement devient un nouveau chapitre de son existence; Jean-Jacques Rousseau garde en mémoire son séjour vénitien. En racontant cette période dans le lazaret, Jean-Jacques Rousseau se souvient qu’il avait transformé son séjour en une période d’exploration des lieux, d’échanges culturels, de lectures passionnantes.
Avant les quelques déceptions qu’il vivra à Venise, Jean-Jacques Rousseau aime se remémorer les moments agréables imposés par l’obligation de rester plusieurs jours, dans un lieu isolé. Ce blocage inattendu engendre un retard dû à la peste de Messine, dit-on.
Aucune importance, fidèle à son goût de l’inattendu, Jean-Jacques Rousseau, sait faire bonne grâce à mauvais jeu. Il commence à relever ses impressions, à noter ce qu’il aime observer. Un jour, cela pourrait peut-être servir. Son cœur enregistre mieux que son cahier où il écrit ses impressions, ses rencontres, ses interventions. De sa plume, il existe des rapports hebdomadaires, il s’agit là de notes officielles. Avec les années, ces mois vénitiens deviendront un des Livres des Confessions. Le Citoyen de Genève ignore qu’un jour, à l’âge de 50 ans, il publiera Le Contrat social, De L’Emile et. La Nouvelle Héloïse, ouvrages qui donneront à l’être humain une nouvelle place dans la société.
Aujourd’hui, le monde frappé par une pandémie voudra-t-il penser le destin de la planète en accord avec un fléau international et le risque de le voir resurgir ? Lorsque nous déciderons de poser les bases d’une société respectueuse des richesses de la planète, lorsque que nous nous serons inspirés de l’appel rousseauiste entre autres messages et lorsque nous aurons écrit un nouveau contrat social, serons-nous devenus les jardiniers de notre univers ? Miroir de notre être, l’univers sera alors une priorité consciente de notre cheminement humaniste. Nos enfants et nos petits-enfants reconnaîtront-ils de quelle manière ce Nouveau Contrat Social aura insufflé une nouvelle façon de bien nommer les urgences planétaires ? La puissance exceptionnelle des peuples travaillant ensemble, construira-t-elle un monde devenu porteur des plus modeste et des plus ambitieux gestes de fraternité ? Au-delà de la Mer rouge de la pandémie donnons un avenir aux beautés de la Nature.
Sources
- Jean Giono, Le hussard sur le toit, Gallimard, 1951
- Albert Camus, La Peste, Gallimard, 1947
- Jean-Philippe Barde, Terre en péril terre en partage, Editions Scriptura, 2019, p. 101
- Jean-Jacques Rousseau, OC I, p. 296
Rémy HILDEBRAND
Genève, Avril 2020
Président-fondateur du « Comité européen Jean-Jacques Rousseau »
Depuis plus de 30 ans, cette institution (CEJJR) s’emploie à mieux faire connaître la vie et l’œuvre de Jean-Jacques Rousseau ; publications, colloques, articles, visites, enseignement.